
La mode des pendules en marbre noir.
En 1812 Jean Joseph Lepaute présente à l’Empereur une nouveauté des pendules en marbre noir en forme de Borne Antique, les bronzes dorés au feu sont de Thomire. Napoléon en achète plusieurs l’une d’elles lui plait particulièrement ; il la fait placer dans sa chambre à coucher. Cette pendule fera partie de ses bagages lorsqu’il partira pour l’Ile d’Elbe ; après bien des péripéties elle a retrouvé sa place. On peut la voir de nos jours dans la chambre de l’Empereur au Château de Fontainebleau.
Les marbres "sciés mince".
Celui qui est employé en horlogerie provient des carrières des Ardennes belges
Son grain très fin et très homogène, la rareté des fossiles et des veines de calcite favorisent son utilisation en marbrerie. Il prend un poli d’un noir parfait, d’une uniformité et d’un velouté incomparable, qui en font un matériau précieux. Il est particulièrement apprécié pour la décoration intérieure, ainsi que pour la sculpture fine.
C’est un peu après 1800 que les ouvriers trouvèrent le moyen de scier ce marbre en fines lamelles de 7 mm qui, une foi façonnées et polies glace, donnaient des planches de 6 mm d’épaisseur qui ont été très employées pour la décoration intérieure ; et ceci permit également la création de toute une série de boites de pendules de formes géométriques.
Le marbre noir des Ardennes est d’une qualité exceptionnelle, les carrières sont à proximité de Paris, elles sont exploitées par des ouvriers très expérimentés. De surcroit les prix sont beaucoup moins élevés car il y a très peu de frais de transport.
Si au niveau technique la Pendule de Paris a conservé toutes ses qualités, on ne peut pas en dire autant au niveau artistique. Il est vrai que lorsque l’industrie s’empare de l’art elle lui donne rarement des lettres de noblesse.
La pendule préférée de Napoléon, elle est dans sa chambre au château de Fontainebleau.
L’arrivée sur le marché du régule.
Ce nom de régule désigne deux métaux bien différents : un alliage d’étain et d’antimoine utilisé dans l’industrie en tant qu’alliage antifriction et dans le milieu de la brocante et des antiquités, appellation impropre mais usuelle, d’un alliage de zinc auquel on a ajouté un peu de plomb pour lui donner à peu près la même densité que le bronze. Il est dit aussi " bronze-imitation" (l’arnaque est à portée de main). Les mauvaises langues disent que pour augmenter encore plus leurs profits ces " bronziers" utilisaient le zinc déposé des toitures des immeubles parisiens lorsqu’il était trop vieux et qu’il fallait le remplacer et le plomb qui venait des caractères d’imprimerie lorsque eux aussi était trop vieux. Ce qui fait que la matière première était quasiment gratuite.
Naturellement il y avait des artisans qui travaillaient correctement et une belle statuette en régule vaut beaucoup plus qu’un mauvais bronze.
Son point de fusion est assez bas, il est donc facile à couler et permet l’emploi de moules en acier ce qui fait que le même sujet peut être reproduit de nombreuses fois. La technique est simple ; on introduit le métal en fusion dans le moule et on fait tourner celui-ci lentement jusqu’au refroidissement. C’est le même tour de main que celui des pâtissiers pour faire les œufs de Pâques en chocolat.
Pour distinguer le régule du bronze véritable, il suffit dans un endroit abrité du regard de rayer la surface de l’objet : si la rayure est argentée c’est du régule, si la rayure est dorée c’est du bronze.
Les Francs-Comtois sont intelligents et dynamiques, les trois principaux fournisseurs se groupent et ouvrent à Paris un dépôt rue Vielle du Temple dans le Marais au cœur même du centre de l'horlogerie parisienne. Ils offrent un large éventail de mouvements; entre 1880 et 1910 la production était de 400.000 mouvements par an et plus de la moitié étaient des pendules de Paris.
Si jusqu’à la fin du programme le mouvement a gardé sa haute qualité il n’en a pas été de même pour l’habillage. Trois événements techniques vont venir modifier les travaux de fabrication.
La dorure électrolytique.
La dorure au mercure a été remplacée par la dorure électrolytique pour le plus grand bien des ouvriers doreurs. C’est l’orfèvre français Chartes Christofle qui en 1843 fit les premières applications de l’électrolyse pour dorer les métaux mais les pièces dorées par ce procédé sont beaucoup moins belles. La dorure moins épaisse est très fragile, elle disparait facilement avec, par exemple, une application du fameux Miror.
Pons part pour St Nicolas ou il réorganise complètement la production et un an après Bréguet chargé de faire une inspection fait un rapport des plus élogieux.
La production a été multipliée par 24 là où un ouvrier mettait quatre jours pour faire un mouvement ; il en fait six par jour.
Les prix aussi ont changés avant un mouvement était payé 25 francs, et le pauvre ouvrier gagnait à peine de quoi vivre. Pons vendait ses mouvements 8 francs.
L’affaire était rentable, elle aurait du connaitre une forte croissance mais le dynamisme commercial de Pons et de ses successeurs Duverdré et Bloquel était plutôt tiède. Entre 1810 et 1910 il ya eu environ 2 millions de mouvements de Paris de fabriqués à St Nicolas.
En pays de Montbéliard, à Beaucour les Japy, le père et ses trois fils sont de gros industriels, ils exploitent depuis 1777, une importante usine qui fabrique des ébauches de montres. Flairant la bonne affaire ils achètent en 1810, à quelques lieues de Beaucour, à Badevel un moulin. Ils le transforment en un an en une unité de production de mouvements de pendules. La demande est en constante augmentation et des concurrents s'installent. Jean Vincenti puis Samuel Marti ce qui fait du pays de Montbéliard le plus important centre de fabrication d’horlogerie de moyen volume.

Jean Baptiste Nompère Comte de Champagny

Dans la page précédente (Les conseils de Papyclock 3) nous avions évoqué la période artisanale. Dans cette page nous allons examiner la période industrielle.
La période industrielle 1820-1950.
Il y a eu à St Nicolas d'Alieremont une petite production d'horloges de parquet qui se trouva subitement ruinée par l'arrivée de la Comtoise et les malheureux horlogers se trouvèrent dans une misère noire. Il y eut en 1805 49 enfants morts faute de soins et de nourriture. Le préfet de Seine "inférieure" Savoye-Rollin fait un rapport alarmant à son ministre. Celui-ci Jean-Baptiste de Nompère Comte de Champagny est un des plus grands ministres de l'intérieur que la France ai connu, de plus c'est un ami de l'Empereur. Il n'y va pas par quatre chemins: il donne l'ordre à l'Académie des Sciences de trouver immédiatement un homme compétent pour sauver l'industrie horlogère alièremontaise. Deux académiciens Marie Prony et Ferdinand Berthoud sont chargés de résoudre le problème.
Berthoud pense à Honoré Pons un jeune pendulier chez qui il se fournit en blancs-roulants. Pons est un ancien élève d'Antide Janvier, il a travaillé chez les Lepaute et vient de s'installer rue de la Huchette dans l'ile de la Cité pas très loin du "triangle d'or" ou sont installés tous les grands de l'horlogerie Breguet, Berthoud et les autres. Comme les demandes son en constante augmentation, il a créé des machines-outils qui lui permettent de satisfaire plus de clients. Prony et Berthoud lui proposent de prendre en mains les destinées de St Nicolas.
Pour l’encourager l’Etat lui rachète un bon prix ses machines-outils et les met à sa disposition pour équiper ses ateliers de St Nicolas. C’est ce que nos jours nous appelons une subvention.

Les conseils de Papyclock 4
Ils réalisent...
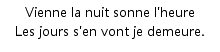
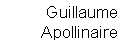
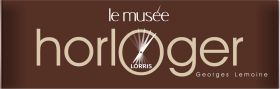

Copyright © 2008-2023. Musée Horloger de Lorris Georges Lemoine, Tous droits réservés.